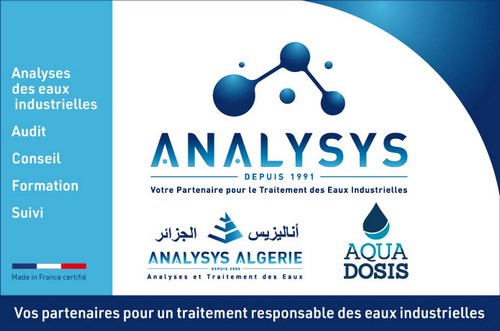Djamel BELAID, Conseiller agronome« Les petits élevages méritent de gagner en professionnalisme »
- Création : 1 septembre 2025

Selon l’expert agronome, Djamel Belaid,face au retard de la sélection génétique actuelle, il est possible d’aller vers le développement de « croisements industriels » notamment dans le but d’approvisionner les abattoirs d’Alviar. Il s’agit selon notre spécialiste d’importer des béliers de race à viande pour les croiser avec des brebis de races locales. Et ce, pour obtenir des agneaux à croissance rapide élevés dans des enclos.
Agroligne : A l'ère où l'accent est mis sur la sécurité alimentaire via le développement des filières stratégiques, quelle place pour l'élevage dont les professionnels font face à de nombreuses contraintes?
M. Djamel BELAID : Les filières stratégiques définies par les pouvoirs publics concernent plusieurs cultures : céréales, oléagineux, légumes secs, maïs grain. L’élevage est concerné à travers la réduction des importations de poudre de lait. Il est possible d’établir un classement par rapport aux besoins d’irrigation : lait avant viande rouge, viande blanche avant viande rouge, légumes secs avant viandes blanches. Les priorités exprimées par les pouvoirs publics concernent le maïs grain par rapport au maïs ensilage. Le premier est utilisé en aviculture alors que le second est actuellement détourné par des éleveurs vers la production de viande rouge. Autre exemple, la priorité accordée aux légumes secs avec l’annonce en 2023 d’un plan national de relance de leur production. Les lentilles, pois chiche et fèves sont particulièrement consommés en Algérie en hiver et sont des aliments riches en protéines végétales et à ce titre, selon les nutritionnistes, ils font jeu égal avec la viande. Résumons-nous. L’accent est mis sur l’élevage laitier et l’aviculture. L’importation de moutons pour l’Aïd est ponctuelle. Quant à l’engraissement de jeunes bovins, la filière locale est en déshérence suite à l’arrêt des importations. En cause, les risques sanitaires liés à l’extension de la maladie hémorragique épizootique en France. L’élevage reste important pour son fort taux d’emplois. Pour de nombreuses personnes sans emploi, l’élevage d’une vingtaine de brebis ou d’un millier de poules assure un revenu minimal.
Quelle adaptation face aux changements climatiques et quel accompagnement apporter aux petits éleveurs ?
A partir de 25°C, les vaches souffrent de la chaleur. Les moutons préfèrent se mettre à l’ombre en été dès que cela leur est possible et il nous a été donné de voir en été en milieu de journée en plein champs des moutons immobiles, hébétés par la chaleur. Quant au poulet de chair, nombreux sont les éleveurs qui arrêtent leur activité en été de crainte de surmortalité. Ces dernières années, l’augmentation des températures et la baisse des pluies notamment dans les wilayas de l’ouest du pays a surtout affecté la disponibilité en fourrages. Au printemps 2023, les éleveurs de la wilaya de Tiaret imploraient le wali d’avancer de 15 jours la date de location des Mahmiyates, ces parcours steppiques loués par les APC. En période de sécheresse, que ce soit en zone steppique ou en montagne, la situation des petits éleveurs est difficile. Dans le premier cas, ils ne disposent pas de camion pour transporter leurs animaux vers des pâturages plus verts. Dans le second, du fait de surfaces fourragères réduites et de leur dépendance aux achats d’aliments, ils sont fragilisés par la hausse des prix. En période de sécheresse, la botte de paille peut passer de 20 DA à 120 DA. Dans le sud de la wilaya de Tébessa, certains éleveurs disent ne survivre que grâce aux plantations d’opuntia et aux raquettes qu’ils donnent à manger aux animaux. En zone rurale, face au manque d’emplois souvent le seul revenu provient de l’élevage. Face à la surcharge des animaux, le milieu naturel se dégrade, la végétation n’a pas le temps de se renouveler. Pour de nombreux spécialistes, la solution passe par la création d’emplois et la reconversion d’une partie des éleveurs. La lutte contre l’importation, dont celle par cabas, et la création de zones industrielles restent la seule solution.
L’initiative de cet investisseur d’Aïn Azel qui, après 20 ans dans l’import, est passé à la fabrication de brosses à dents, briquets et autres objets courants est salutaire. On le voit, l’élevage steppique dépasse le seul cadre de l’agriculture. L’aide aux petits éleveurs pourrait concerner l’accès à des aliments de substitution en période de soudure et leur orientation vers des ateliers de valorisation des produits animaux. La décision de 2021 du ministère du commerce d'autoriser les agriculteurs à vendre directement leurs produits aux consommateurs est salutaire. Les petits élevages sont dans leur grande majorité informels et méritent de gagner en professionnalisme notamment en matière de biosécurité. Le parasitisme lié au non-respect des normes d’hygiène est la cause d’affections dont des coccidioses qui se traduisent par un gaspillage d’aliment. Fin 2024, le ministère de l’Agriculture a promulgué un décret qui permet aux éleveurs de volailles informels de régulariser leur situation.
La disponibilité en fourrages reste faible, notamment en zone steppique. Cela est lié au surpâturage et à la réduction des pâturages suite à l’extension des labours et de la plantation d’oliviers ou d’arbres fruitiers. Des améliorations sont possibles car l’élevage reste de type cueillette. Les éleveurs font pâturer leurs troupeaux de moutons sur les terres Arch sans jamais planter des arbustes fourragers comme le fait le HCDS (haut commissariat au développement de la steppe) et les services forestiers. Il pourrait leur être proposé de contribuer à ces plantations, quitte à être prioritaires pour la location saisonnière de ces parcelles. L’atriplex est un arbuste très prisé par les moutons pour sa valeur alimentaire. En Australie, il a été sélectionné des variétés très productives qui sont plantées de façon mécanisée à large échelle. Une façon de faire qui mérite l’intérêt. La production de fourrage a bénéficié de la loi relative à l'accession de la propriété foncière agricole et aux aides publiques à l’irrigation. A Naâma ou M'sila les superficies de fourrages irrigués ont nettement augmenté. A El Mniaa, on peut voir des agneaux gambadant dans des champs de luzerne irrigués par pivot. Là, comme dans d’autres wilayas, la récolte mécanique de maïs fourrage conditionnée en balles rondes a constitué une révolution technique. Cependant, cette production concurrence celle du maïs grain dont les importations atteignent 4 millions de tonnes et sont indispensables à l’élevage de poules. La production de fourrages irrigués se traduit par une concurrence pour l’eau avec des cultures stratégiques. Quant aux fabricants d’aliments du bétail, à l’image de la Laiterie Soummam qui a commencé à produire des fourrages à Ouargla, ils pourraient être encouragés àsubstituer leurs importations par un approvisionnement local. Cela, en apportant appui technique, matériel, voire financier à des agriculteurs sous contrat produisant maïs grain, orge, triticale ou féverole.
N' y a t -il pas lieu de restructurer l'élevage? Une restructuration est indispensable. L’élevage ovin steppique est actuellement un facteur de désertification. Pour de nombreux spécialistes, il devient nécessaire de réduire la charge d’animaux à l’hectare. Faudra-til passer par la définition de quotas de moutons par wilaya ? Cet hiver, pour la première fois, la wilaya de Béchar a interdit aux éleveurs des autres wilayas l’accès de ses parcours reverdis après les pluies. Face au retard de la sélection génétique actuelle, il est possible d’aller vers le développement de « croisements industriels » notamment dans le but d’approvisionner les abattoirs d’Alviar. Il s’agit d’importer des béliers de race à viande pour les croiser avec des brebis de races locales afin d’obtenir des agneaux à croissance rapide élevés dans des enclos. Pour les nourrir, ces élevages seraient alimentés par des fourrages cultivés. Enfin, il s’agit d’utiliser les résultats de la recherche agronomique locale dont ceux relatifs à l’enrichissement de l’orge et de la paille en urée, un produit dont les excédents sont actuellement exportés aux dépens du secteur de l’élevage. Il en est de même avec la mélasse sucrière issue des raffineries de sucre roux. L’élevage a besoin d’organisations professionnelles à même de relayer les actions des services agricoles et vétérinaires. Il est dramatique de voir l’absence de techniciens d’élevage et de vétérinaires sur les marchés hebdomadaires, lieu de rassemblement des éleveurs.
Qu'attendre des mégas projets annoncés dans ce cadre?
Les méga-projets peuvent permettre un transfert de technologie notamment en matière de production de fourrages à large échelle, de génétique et de gestion moderne des troupeaux. Que ce soit en Arabie Saoudite, Qatar ou EAU, la luzerne qui approvisionne les méga-fermes de ces pays désertiques provient du Soudan, USA, ou Brésil. A Adrar, le partenariat avec Baladna vise une production locale de luzerne. Le défi réside donc dans les disponibilités sur le long terme en eau. Avec une capacité annuelle de 10 000 têtes dans sa ferme de 3 850 hectares située au niveau du delta du Pô, l’italien Bonifiche Ferraresi possède une expérience de l’engraissement des veaux. Aussi propose-t-il un partenariat pour la production locale de viande rouge. Pour produire du lait ou de la viande, les besoins en irrigation ne sont pas identiques. Selon les estimations, il faut 1 000 litres d’eau pour produire un litre de lait mais 15 000 litres d’eau pour un kilo de viande rouge.
Ces défis nécessitent la définition d’une stratégie sur le long terme. Enfin, avec l'importation massive des viandes et du cheptel ovin pour l'Aid, quel impact sur le marché? L’importation massive de moutons a fait baisser de plusieurs dizaines de milliers de dinars les prix. Déjà, l’an passé, à elles seules, les rumeurs d’importation ont fait baisser les prix et réduit les transactions sur les marchés aux bestiaux. La préparation de l’Aïd 2025 est marquée par l’importation massive de moutons. Cela doit être l’occasion d’une prise de conscience. En Algérie et en Tunisie les prix ont flambé. Au Maroc, un cap a été franchi : annulation du sacrifice. Faudra-t-il revenir au sacrifice d’un mouton par famille élargie comme dans les années 1960 ? Au-delà du mouton de l’Aïd, le déficit en viande s'accroît avec le dérèglement climatique et se traduit par de coûteuses importations. A travers l’irrigation des fourrages, l’élevage consomme une eau précieuse pour le développement des cultures stratégiques. La part de l’agriculture dans les prélèvements d’eau est estimée à plus de 70% au niveau national. Lors de son voyage à Béchar, le chef de l’Etat a averti que l'eau transférée sur 120 km depuis la zone de captage de Guetrani ne devra servir qu’à l’AEP. Ces derniers temps, à plusieurs reprises, le chef de l’Etat a évoqué l’évolution future de la population algérienne vers 50 millions d’habitants. Aussi, s’agit-il de réfléchir au modèle de consommation alimentaire souhaitable. Dans un pays à dominante semi-désertique, il est illusoire de vouloir suivre le modèle occidental basé sur la consommation de produits laitiers et animaux. Pour les nutritionnistes, l’organisme humain a besoin de protéines contenant des acides aminés variés dont 8 sont essentiels et se trouvent dans le plat national : le couscous aux pois-chiche. Le défi est donc d’allier des protéines animales à d’autres d’origine végétale et de ne pas passer à côté de la révolution technologique liée à la transformation des légumes secs. Aujourd’hui, pour les adultes, il est possible de produire du « lait » végétal à base d’avoine, des pâtes alimentaires enrichies en farine de lentilles ou de Nuggets et aiguillettes de poulet à base de protéines de pois texturées. La production de ces analogues de viande requiert moins d’eau et pourrait réduire la tension actuelle sur le marché de la viande. A l’étranger des firmes comme Herta, Bjorg ou Isla Délice innovent constamment. La FoodTech progresse en Algérie grâce aux efforts de Yacine Oualid lors de sa nomination en 2020 comme ministre délégué chargé des start-up.
Source: Rédaction agroligne